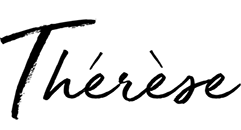A l’école de la libération sexuelle, on nous a dit que le sexe c’est quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. Pouvoir baiser comme un homme, c’est être féministe, vraiment ?
Il suffit d’avaler des pilules. Ou plus exactement, il suffit que nous les femmes nous avalions des pilules. Une pour empêcher la conception, une pour empêcher la nidation, deux autres pour empêcher le développement d’un amas de cellules que l’on nomme embryon. Elles sont formidables ces pilules. Elles nous débarrassent du problème bébé, celui-là même qui entrave jouissance sexuelle et épanouissement personnel. Non pas que le bébé soit un problème, au contraire. Il est un objet de jouissance. Si on l’a quand on veut, comme on veut, avec qui on veut. La maternité est alors magnifiée à l’image de Beyoncé posant telle une madone avec ses jumeaux, icône d’un féminisme triomphant. Et nous on y croit.
C’est fou comme la promesse de liberté nous ferait gober n’importe quoi, comme par exemple, qu’un produit agissant négativement sur notre sexualité puisse la libérer. Une maîtrise de la fécondité est certes nécessaire pour s’abandonner charnellement sans craindre un enfant. Mais comment peut-on porter aux nues un médicament qui supprime le pic oestrogénique en période péri-ovulatoire, les variations d’ocytocine permettant une lubrification vaginale et diminue la libido en augmentant de façon irréversible le taux de SHBG (Sex Hormone Binding Globulin) qui diminue les taux de testostérone libre et donc la libido ? Tandis que les femmes se castrent chimiquement, les hommes, eux, restent intacts sans que personne n’y trouve quoique ce soit à redire. Dans le fond, rien d’étonnant à cela. Chaque culture a toujours produit des stratégies pour limiter la puissance sexuelle des femmes car, selon l’anthropologue Françoise Héritier, « les femmes incarnent la sexualité sauvage, débridée, mais aussi parce qu’elles incarnent la passivité pénétrée, c’est-à-dire dans les deux cas la dévoration d’énergie mâle »[1]. La contraception hormonale vendue sous couvert d’émancipation permet en réalité d’exercer un contrôle permanent sur la vie sexuelle des femmes par les femmes elles-mêmes, et c’est bien là le tour de force de système. Plus besoin de prescriptions religieuses, plus besoin de réglementations juridiques : sans que personne ne s’en aperçoive, le contrôle s’exerce en permanence à l’intérieur du corps des femmes pour le discipliner.
En supprimant volontairement la capacité d’engendrer un nouvel être humain, le corps des femmes est désormais disposé et assigné à recevoir et procurer du plaisir sexuel. « Jouissez sans entrave » n’est pas seulement un slogan écrit sur les murs, il est aussi un impératif imposé insidieusement par la nouvelle disposition du corps féminin. La sexualité est devenue un produit de consommation comme un autre. Ce que l’on dit moins, c’est qu’être « libre sexuellement » signifie aussi permettre aux hommes de jouir dans leur corps sans se préoccuper des conséquences de l’acte sexuel. Rien ne limite l’assouvissement de la pulsion sexuelle masculine et, quand bien même ce rapport de force entre les sexes aurait toujours existé, la contraception hormonale l’a renforcé. La sexualité pulsionnelle, récréative, génitale, mécanique et technique est alors exaltée. Les notions de performance, d’efficacité et de réussite autrefois réservées au monde économique sont introduites dans le domaine de l’intimité, la culture pornographique étendue à tous les champs de la société déshumanisant femmes et hommes instrumentalisés au profit d’un plaisir devenu tyrannique. On assiste désormais à une nouvelle forme d’aliénation : la soumission à la pulsion. A qui profite donc ce libéralisme sexuel ? Certainement pas aux femmes, pas plus aux hommes. Réduits à n’être qu’un sexe sur pattes, sollicités à outrance, ils sont tout autant victimes de cette hyper-sexualisation de la société. En réalité, ce libéralisme sexuel profite à la logique du marché qui gagne à nous maintenir au stade pulsionnel pour provoquer l’acte d’achat, pousser à la consommation en faisant de nous des enfants capricieux qui maximisent leur plaisir à coup de « c’est quand je veux, si je veux, comme je veux ».
Le lien entre libéralisme sexuel et libéralisme économique n’est pas hasardeux à partir du moment où le féminisme le défendant a pour emblème la pilule. Fabriquées par les entreprises pharmaceutiques, délivrées en pharmacie, prescrites par le médecin, demain disponibles en supermarché, ces pilules contraceptives, contragestives et abortives impliquent non seulement un lien de dépendance avec le médecin mais surtout un lien mercantile avec leurs producteurs. La médecine se présente depuis comme le « gestionnaire de la liberté des femmes » non pas au sens de l’impératif « Sois libre !», avec la contradiction immédiate que cet impératif peut porter mais au sens de « Je vais te produire de quoi être libre ou je vais faire en sorte que tu sois un être libre »[2]. Dès lors, cette liberté se vit toujours dans la dépendance et risque à tout moment d’être refusée, limitée ou détruite. Cette désappropriation est une forme d’aliénation. Dépossédées des savoirs sur leur propre corps, les femmes sont maintenues dans un lien de dépendance aux médecins certes, mais elles sont surtout soumises à une logique économique. C’est une liberté conditionnée à un acte d’achat, c’est une liberté qui requiert un acte de consommation.
Cette forme de dépendance est rendue possible par l’état d’ignorance dans lequel sont maintenues les femmes. Mises sous pilule au sortir de l’enfance, la transmission des savoirs sur la fertilité est rendue obsolète. A quoi bon initier les jeunes filles à connaître leur corps, comprendre leur cycle, repérer leurs jours de fertilité puisque la contraception hormonale vient tout modifier ? Ce serait même extrêmement gênant si les femmes possédaient un savoir sur leur corps. Celui-ci leur confèrerait un pouvoir qui les rendraient autonomes mais aussi critiques vis-à-vis des produits qu’on tente de leur faire ingurgiter. En effet, ce sont des médicaments. Et comme tous les médicaments, il existe des effets secondaires possible. Et si ce médicament bouleverse l’écosystème féminin, il impact tout autant négativement l’environnement. Or, les femmes ne sont pas malades. Elles sont mêmes en bonne santé si elles peuvent enfanter. Le risque, ce serait donc de provoquer la pathologie sur un corps sain, le risque ce serait de rendre malade des femmes qui ne le sont pas. En 2013, le scandale des pilules de troisième génération éclate au grand jour. Depuis, la méfiance est perceptible. A quand maintenant la prise de conscience écologique ? Mais les alternatives fondées sur la connaissance des femmes de leur propre corps restent discréditées au profit d’une médecine qui se présente encore comme toute puissante, pieds et poings liés aux entreprises pharmaceutiques, elles-mêmes soumises aux rouages d’un capitalisme sans visage.
Le féminisme véritable, celui soucieux de la cause des femmes et par la même de la relation avec les hommes et les enfants à qui elles donnent naissance, ne peut pas avoir pour symbole la pilule. Elle est au contraire le signe de la soumission. Seule la connaissance de la fertilité par les femmes elles-mêmes permet une autonomie réelle. « Faire confiance aux femmes », elles peuvent se connaître, « faire confiance aux hommes », ils peuvent se maîtriser : voilà sur quoi peut se fonder une relation d’égalité. La sexualité se vit dès lors au rythme des périodes du cycle féminin et du désir de se rencontrer: il y a des temps pour s’unir, il y a des temps où abstenir ouvrant à une multitude de manière de se dire l’amour autrement.
[1]HERITIER Françoise, Masculin/féminin : dissoudre la hiérarchie, Odile Jacob, 2002, p.59-60.
[2]Naissance de la biopolitique : cours au Collège de France, Michel Foucault, Gallimard Hautes Etudes, Paris, 2004, p.65.